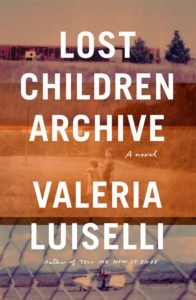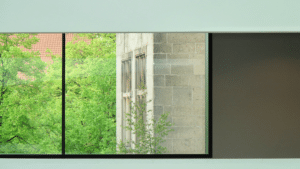André Markowicz poste, depuis des années, des billets réguliers sur Facebook. Ils concernent son travail d’écrivain, de traducteur, mais aussi – et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine -, son rapport à la Russie, ce que cette violence lui inspire, ce qu’il y reconnaît de l’arrogance du régime poutinien. Sa connaissance, sa familiarité extrême avec la langue et avec la culture russes sont précieuses.
Je transcris, ici, un extrait du post qu’il a déposé en ce 1er mai 2022. Pour ce qu’il en dit de son travail d’écrivain. Remarquable, ce « faire attention aux mots », cette attention « aux mots eux-mêmes ». Cela compte pour moi aussi. Fraternité du soin.
Mais c’est quoi, ma spécialité, à moi qui ne sais même pas faire la planche, et qui n’ai jamais pu apprendre à nager à la piscine, parce que le maître-nageur me disait « sois cool », et que, donc, je coulais ?
Est-ce qu’on peut dire que, ma spécialité, c’est d’écrire ? Genre, je suis un écrivain. Et un écrivain, c’est quelqu’un qui fait, comme on dit, une œuvre. Sauf que, la seule chose que je ne fasse pas, c’est justement une œuvre d’écrivain, parce que je ne fais pas de fiction. La seule chose que je ne puisse pas m’imaginer de faire, c’est d’écrire un roman, avec ou sans marquise qui sortit à cinq heures.
J’essaie de faire attention aux mots. De faire attention aux mots, ça veut dire faire attention aux mots eux-mêmes, aux mots dans la façon dont ils sonnent, dans ce qu’ils disent vraiment, ou ce qu’on pense (ou qu’on imagine) qu’ils disent, les mots précis, ceux-là et pas d’autres (d’où, finalement, aussi, mes traductions) ; ça veut dire aussi ce qu’ils peuvent porter ensemble comme rythmes, comme musique, comme images (d’où mon travail sur la poésie — appelons ça comme ça, sur la concentration des mots dans un minimum d’espace sonore) et ça veut dire, en même temps, bien sûr, essayer de faire attention à ceux qui les disent, ces mots, aux gens qui parlent, à la façon dont ils parlent, à pourquoi ils parlent, aussi. Faire attention, d’une façon ou d’une autre, à la vie qu’il y a, non pas derrière, mais dedans. Essayer, je ne sais pas, d’être vivant parmi d’autres vivants. Juste une personne parmi les autres. Et c’est l’attention aux mots, si monstrueux soient-ils, qui fait la matière même de mes chroniques sur la guerre d’Ukraine.
Avec cette particularité que j’ai, qui est à la fois un trésor et une calamité, d’avoir deux langues, et donc d’être à la fois, partout, à la fois et dehors et dedans. C’est ce qui explique que, quand j’écris en français, — qu’il s’agisse de traductions (c’est-à-dire de textes écrits en français dont il existe une version première dans une autre langue) ou de textes non-traduits (au sens où il n’existe pas de version première précise avant ce que le lecteur a sous les yeux), on sente toujours que, derrière ma langue française, il y a une autre langue — peut-être, inch allah, un autre monde.