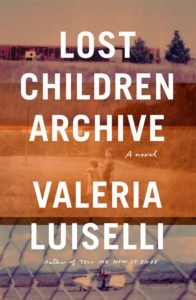
Valeria Luiselli a écrit le très beau Lost Children Archive, traduit en français par Nicolas Richard sous le titre Archives des enfants perdus (Éditions de l’Olivier, 2019). J’y trouve, page 88, cette intuition de ce que peut représenter la lecture, de ce qu’elle a représenté et représente encore souvent pour moi.
(…) quand j’ai lu Sontag pour la première fois, tout comme la première fois que j’ai lu Hannah Arendt, Emily Dickinson et Pascal, je n’ai cessé d’avoir des ravissements soudains, subtils, voire microchimiques – de petites lumières clignotant en profondeur à l’intérieur du tissu cérébral – que certaines personnes éprouvent quand elles retrouvent finalement les mots pour désigner un sentiment très simple et pourtant jusqu’alors tout à fait indescriptible. Lorsque les mots de quelqu’un d’autre pénètrent comme cela dans votre conscience, ils deviennent de petites balises conceptuelles. Ils n’illuminent pas nécessairement. Une allumette craquée dans un couloir sombre, l’extrémité d’une cigarette fumée au lit à minuit, les braises d’un feu à l’agonie dans la cheminée: rien de tout cela n’a en soi suffisamment de lumière pour révéler quoi que ce soit. Les mots de quiconque non plus. Mais parfois, une lueur peut vous faire prendre conscience de l’obscurité, de l’espace inconnu qui l’entoure, de l’énorme ignorance qui enveloppe tout ce que nous croyons savoir. Et le fait d’en prendre conscience, et le fait de reconnaître la présence de l’obscurité importe davantage que toute la connaissance factuelle que nous pouvons accumuler.


