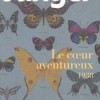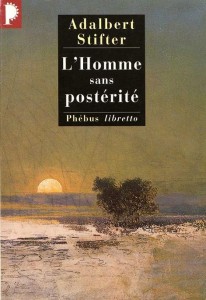 L’Homme sans postérité (Der Hagestolz) est ce magnifique petit roman de Adalbert STIFTER (1805-1868), que recommande Sebald. Le personnage principal en est ce jeune homme dont la vie d’adulte va commencer par une visite à son oncle, un vieil homme reclus, vivant dans une île quasi inaccessible. Mais comme le titre l’indique, c’est cet homme sans postérité qui est central, dont la vie – prospère – se résume à une solitude effrayante, entièrement refermée sur son passé. La figure du vieil homme couvre de son ombre tout le récit.
L’Homme sans postérité (Der Hagestolz) est ce magnifique petit roman de Adalbert STIFTER (1805-1868), que recommande Sebald. Le personnage principal en est ce jeune homme dont la vie d’adulte va commencer par une visite à son oncle, un vieil homme reclus, vivant dans une île quasi inaccessible. Mais comme le titre l’indique, c’est cet homme sans postérité qui est central, dont la vie – prospère – se résume à une solitude effrayante, entièrement refermée sur son passé. La figure du vieil homme couvre de son ombre tout le récit.
Les dernières lignes du roman:
Toujours et toujours le soleil fera descendre sa lumière, toujours le ciel bleu sourira, de millénaire en millénaire, et la terre se revêtira de son ancienne verdure et les générations descendront leur longue chaîne jusqu’au dernier enfant: lui seul est exclu de tout cela, parce que son existence n’a formé nulle image, parce que ses bourgeons ne lui permettent pas de descendre le fil des temps. Même s’il a laissé après lui d’autres traces, celles-ci s’effaceront comme s’efface tout ce qui est terrestre, et quand enfin tout aura disparu dans l’océan des jours, les choses les plus grandes, les plus grandes allégresses, lui disparaîtra d’abord parce que tout en lui sombre déjà tandis qu’il respire, tandis qu’en lui persiste la vie.