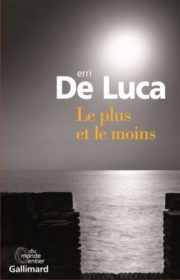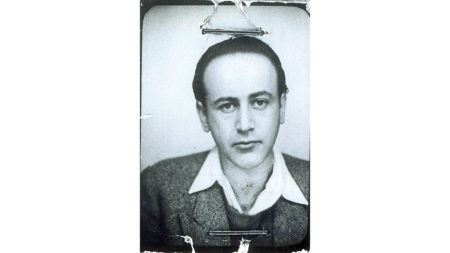En octobre dernier, escapade de quelques jours à Edinburgh où je n’étais plus allé depuis des années. Le temps était à la pluie mais traversé de grandes éclaircies soyeuses dans la lumière de l’automne écossais.
Voici le ciel de pluie sur la vieille ville et le château. Et voici le ciel de la bibliothèque de la Scottish National Portrait Gallery, qui m’évoque immanquablement le plafond constellé de la gare de New York, Grand Central. Correspondances stellaires dans les yeux du voyageur, que sa fatigue et le dépaysement imprévu rendent presque mystérieuses.