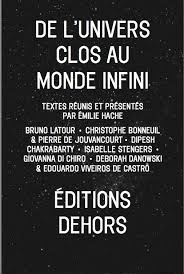Par analogie avec le travail des chercheurs et des philosophes (voir à ce sujet le très riche ouvrage dirigé par Emilie Hache, De l’univers clos au monde infini), je note que les artistes sont dans la nécessité d’inventer aujourd’hui de nouveaux récits. C’est aussi la découverte que j’ai renouvelée récemment en travaillant avec Th.Heynderickx et Martha Rodezno.
Les mots d’Emilie Hache font sens pour un musicien, pour un danseur:
Quels mythes font aujourd’hui tenir le monde face à la possibilité de son démembrement ? (…) Il faut renouveler nos modes de perception, notre sensibilité; pouvoir répondre à ce qui est en train de nous arriver.
Le récit, comme puissance d’affecter et de transformer. [je souligne]
Les récits nous font littéralement tenir debout.(…) il importe de dramatiser ce changement d’une façon qui tienne compte du passé, c’est-à-dire des situations existantes de destruction et de perte… [par analogie encore, le bouleversement de la dramatisation fondée sur notre imaginaire et sur les impulsions du corps en mouvement].
(…) il faut multiplier les zones de contact avec d’autres manières de sentir et de penser. [précisément, dans la pratique artistique, ce n’est pas métaphorique. Le fait que ce ne le soit pas, est essentiel]
(…) ce qui se fait défie toute appropriation.